Le Japon est souvent perçu depuis l’extérieur comme un pays très laïque, voire franchement non-religieux.
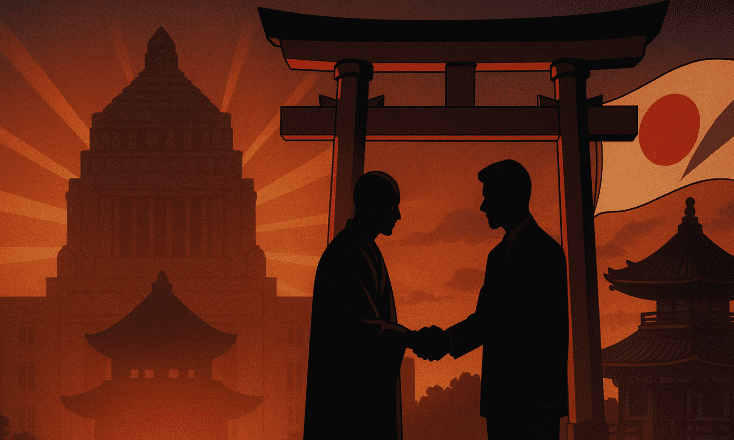
Et pour cause : près de 70 % des Japonais se déclarent mushūkyō (無宗教), littéralement “sans religion”. Pourtant, dans la vie quotidienne comme dans les coulisses du pouvoir, les traditions spirituelles, les réseaux religieux et les rituels ancestraux continuent d’influencer profondément le paysage politique nippon.
À lire aussi sur dondon.media : Religions et croyances au Japon
Ce paradoxe, entre une société qui se dit sécularisée et un terrain politique où les mouvements religieux jouent un rôle stratégique, mérite qu’on s’y attarde avec nuance.
Un pays “non religieux”
Ce que beaucoup d’enquêtes chiffrent comme une absence de religion repose en fait sur un malentendu culturel. Au Japon, shūkyō (宗教), le mot pour “religion”, est souvent associé à des institutions formelles de type occidental : dogmes fixes, hiérarchie cléricale, appartenance exclusive. Or, la vie spirituelle japonaise est souvent informelle, pratique et plurielle.
Ainsi, un Japonais peut se dire mushūkyō tout en allant prier dans un sanctuaire shintō au Nouvel An, organiser des funérailles bouddhistes pour un proche, et participer à des festivals religieux (matsuri) chaque été. Autrement dit, la religion ne s’exprime pas nécessairement par l’adhésion déclarée, mais plutôt à travers des rituels, des habitudes collectives, et des valeurs partagées.
C’est cette forme discrète mais ancrée dans la vie quotidienne qui permet à certaines organisations religieuses d’agir comme des forces politiques. Elles ne s’imposent pas dans les débats nationaux par la rhétorique théologique, mais par le lien communautaire, la solidarité de voisinage et la capacité à mobiliser les fidèles.
Un cadre juridique laïque
La Constitution japonaise, rédigée sous l’influence des forces d’occupation américaines après la Seconde Guerre mondiale, pose un cadre de séparation stricte entre État et religion. L’article 20 garantit la liberté religieuse tout en interdisant toute autorité religieuse au sein de l’État. L’article 89 interdit quant à lui toute subvention publique à des institutions religieuses.
Mais ces règles, bien qu’importantes, n’empêchent pas les croyants de s’engager politiquement. Elles interdisent à l’État d’imposer une religion ou de financer un culte, mais pas aux citoyens croyants, ou aux organisations religieuses, d’exercer une influence politique par les moyens démocratiques classiques : vote, lobbying, association, partis.
C’est dans ce cadre que plusieurs courants religieux se sont durablement installés dans le paysage politique japonais, en particulier à partir de la deuxième moitié du XXe siècle.
Sōka Gakkai et Kōmeitō
Sōka Gakkai est sans doute le cas le plus emblématique d’un mouvement religieux ayant su transformer sa base spirituelle en puissance politique. Né dans l’après-guerre comme un mouvement laïc issu du bouddhisme Nichiren, Sōka Gakkai a très vite développé une organisation sociale efficace, centrée sur l’amélioration concrète de la vie des individus et sur une communauté soudée.
En 1964, le mouvement fonde son propre parti politique : Kōmeitō. Si ce dernier affirme son indépendance depuis 1970, les liens avec Sōka Gakkai restent étroits sur le plan organisationnel. Lors des élections, les membres sont appelés à voter en bloc et à convaincre leur entourage, un “ground game” d’une redoutable efficacité.
Dans un système électoral japonais où les marges sont parfois très serrées, les 10 000 à 20 000 voix disciplinées que Sōka Gakkai peut apporter dans une circonscription peuvent faire la différence. Kōmeitō est ainsi devenu un partenaire indispensable de la coalition gouvernementale menée par le Parti libéral-démocrate (LDP) depuis 1999.
Sur le fond, Kōmeitō s’est positionné comme un parti modéré, socialement engagé : il défend des mesures de soutien aux familles, à l’éducation, à la baisse du coût de la vie, tout en se montrant réservé sur les réformes sécuritaires susceptibles d’affaiblir le pacifisme inscrit dans l’article 9 de la Constitution.
Le Shintō : un pouvoir diffus et présent
Contrairement au modèle catholique ou protestant occidental, le Shintō n’a pas de clergé centralisé, ni de doctrine codifiée. C’est une religion des lieux, des sanctuaires, des esprits (kami), des rites.
Jinja Honchō, l’Association des sanctuaires shintō, chapeaute environ 80 000 sanctuaires au Japon. Elle ne participe pas directement à la vie politique, mais elle est liée à plusieurs réseaux conservateurs, notamment le Shintō Seiji Renmei (Association pour le leadership spirituel) et surtout Nippon Kaigi, influente coalition nationaliste qui regroupe politiciens, universitaires et figures religieuses.
Ce courant prône une réforme de la Constitution, un renforcement de l’éducation morale et une réhabilitation du passé impérial, notamment par le soutien au sanctuaire de Yasukuni, hautement controversé. Ce n’est pas une mobilisation de masse à la Sōka Gakkai, mais une influence par capillarité, par proximité sociale et institutionnelle.
Il faut toutefois noter que tous les sanctuaires ne soutiennent pas cette ligne dure. Des voix s’élèvent aussi au sein du Shintō pour dénoncer les récupérations politiques ou les dérives ultranationalistes.
Autres mouvements religieux
Le paysage religieux japonais est extrêmement varié. De nombreuses nouvelles religions (shin shūkyō) sont nées dans l’après-guerre, avec des formes d’organisation diverses et des ambitions politiques fluctuantes.
Certains mouvements, comme Reiyūkai ou Risshō Kōsei-kai, ont apporté leur soutien à des candidats locaux ou à des partis modérés, misant sur l’influence discrète mais constante plutôt que sur la conquête du pouvoir.
D’autres, à l’image de Happy Science, ont choisi une voie plus spectaculaire : création d’un parti politique (Happiness Realization Party), productions audiovisuelles, messages ésotériques, prises de position radicales sur la sécurité ou l’histoire du Japon. Si leur poids électoral reste marginal, leur présence médiatique est calculée.
Enfin, le parti Sanseitō, fondé en 2020, mélange discours shintō, critique du mondialisme, méfiance vaccinale et nostalgie impériale, avec un fort relais sur les réseaux sociaux. Ce type de formation digitalisée représente une nouvelle forme de populisme religieux.
Le bouddhisme engagé pour la paix
Face à ces influences conservatrices, certains courants religieux adoptent une posture résolument progressiste. C’est notamment le cas du Jōdo Shinshū Honganji, la plus grande école bouddhiste du Japon.
Très impliqué dans la défense de l’article 9 et dans les luttes pour les droits humains, ce courant se distingue par son travail social, notamment en cas de catastrophe naturelle. Après le tsunami et l’accident nucléaire de 2011, de nombreux temples ont servi de relais logistique, d’abris et de centres d’entraide, souvent plus réactifs que les institutions publiques.
Ce “bouddhisme civique” agit rarement en son nom dans l’arène électorale, mais il façonne l’opinion, soutient des ONG, et pèse indirectement sur les priorités politiques locales.
Le scandale de l’Église de l’Unification
Le 8 juillet 2022 marque une rupture brutale. L’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzō Abe, par un homme accusant l’Église de l’Unification de ruiner sa famille, a mis au jour les liens troubles entre cette organisation religieuse d’origine coréenne et une partie du LDP.
Pendant des décennies, l’Église a offert à certains politiciens ses troupes militantes, son expertise logistique, et ses réseaux. En échange, elle a bénéficié d’une relative tolérance malgré ses pratiques controversées (notamment les “ventes spirituelles”).
La révélation de cette collusion a provoqué une onde de choc. L’opinion publique s’est retournée, les médias ont enquêté, et le gouvernement a été contraint de réagir : durcissement des règles de dons, enquêtes administratives, et procédure judiciaire pour retirer à l’Église son statut légal.
Depuis, la relation entre religion et politique est devenue un sujet de vigilance démocratique.
Aujourd’hui : une opinion japonaise lucide
En 2025, les Japonais continuent à se définir majoritairement comme mushūkyō. Pourtant, ils reconnaissent de plus en plus l’impact des réseaux religieux sur la vie politique et exigent davantage de transparence.
La confiance a été entamée, mais les pratiques communautaires liées à la religion gardent une légitimité sociale, surtout dans les contextes d’entraide et de solidarité. La question n’est plus “faut-il séparer religion et politique ?”, elle l’est juridiquement, mais “comment contrôler l’influence des organisations religieuses dans une démocratie locale et communautaire ?”
Ignorer ce maillage discret mais puissant, c’est passer à côté de l’une des clés de compréhension du pouvoir au Japon : ce pays où le religieux ne s’affiche pas toujours, mais agit en profondeur.
📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.
