À travers cette polémique, c’est tout un climat politique, juridique et social qui se dévoile au Japon.
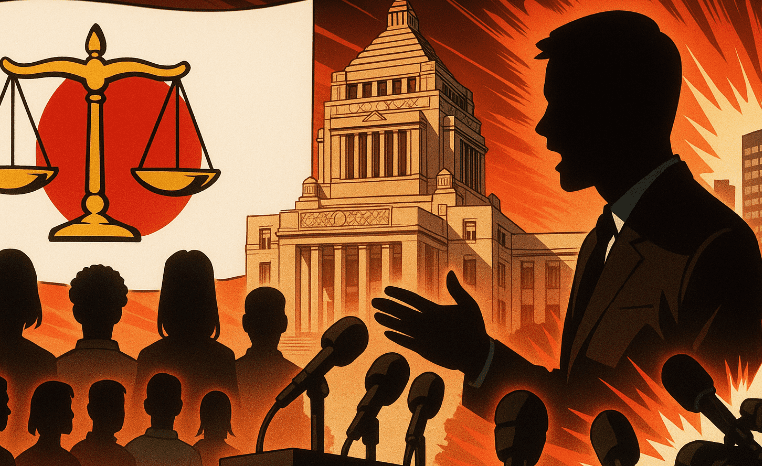
En octobre 2025, une déclaration d’un élu local japonais a provoqué une onde de choc dans les médias et la société civile. Bien plus qu’un simple dérapage verbal, cette phrase pose une question cruciale : quelle est aujourd’hui la place des étrangers dans la société japonaise ?
À lire aussi sur dondon.media : 🎌 Guide de l’étiquette japonaise : la politesse pour les débutants
Tout commence le 1er octobre 2025, lors d’une séance de l’Assemblée préfectorale de Saitama. Moroi Masahide, élu indépendant, affirme sans détour :
« Les étrangers n’ont pas de droits humains fondamentaux. »
Un propos qui choque instantanément, y compris dans les rangs politiques. Le gouverneur Ōno Motohiro le contredit publiquement, rappelant que les droits fondamentaux doivent s’appliquer à tous, quelle que soit la nationalité. Plusieurs élus dénoncent la déclaration comme “profondément inappropriée”.
Face à la tempête médiatique, Moroi tente de faire machine arrière. Il parle d’un propos “incomplet”, concède aux étrangers des droits en tant qu’humains, mais nie l’accès aux mêmes droits civiques que les Japonais. Une nuance juridique certes réelle, mais glissante.
Au Japon, la Constitution garantit des droits fondamentaux à toutes les personnes, y compris les étrangers. Moroi mélange ici droits humains universels et droits de citoyenneté (vote, éligibilité, etc.) – un amalgame qui inquiète dans un contexte politique de plus en plus tendu.
🌍 Kawaguchi, les Kurdes et la zone grise du droit
Cette sortie ne surgit pas dans un vide. À Kawaguchi, une ville de la préfecture de Saitama, vit une importante communauté kurde, forte de 2 000 à 3 000 personnes. Arrivés majoritairement depuis les années 90, beaucoup vivent aujourd’hui dans une incertitude administrative constante.
- Visas provisoires, parfois renouvelés pendant des années
- Libération sous condition, sans droit de travail ni couverture santé
- Pas de statut clair, donc pas de stabilité familiale ni sociale
Cette situation pèse lourd : enfants déscolarisés, accès limité aux soins, logements précaires… Ce n’est pas “l’ethnie” qui crée les tensions locales, mais bien l’incertitude prolongée imposée par l’État.
Et pourtant, Kawaguchi affiche l’un des taux de population étrangère les plus élevés du Japon (8,3 %). Une ville cosmopolite, mais où le décalage entre intégration réelle et reconnaissance légale reste frappant.
🧨 Une rhétorique anti-immigration
Les mots de Moroi ne sont pas un accident isolé. Ils s’inscrivent dans une ambiance où le discours anti-immigration se banalise, notamment en ligne, sur les réseaux sociaux et même dans la rue.
Ces deux dernières années, on a vu :
- des manifestations hostiles dans les quartiers kurdes
- des hashtags xénophobes exploser
- des slogans “Japan First” fleurir sur les murs
Mais les chiffres contredisent cette montée de la peur : selon la Police nationale japonaise, la criminalité est en baisse structurelle, sans surreprésentation des étrangers. Le lien entre immigration et insécurité relève donc plus du fantasme que de la réalité.
🏛️ Sanseito et la politique du bouc émissaire
Le climat national a également basculé avec la montée du parti Sanseito, qui a effectué une percée spectaculaire aux élections sénatoriales de juillet 2025 (14 sièges, 12,6 % des voix). Avec un discours résolument nationaliste, ce parti prône une refonte constitutionnelle supprimant… les droits fondamentaux. Leur slogan ? “Japanese First”.
Dans cette dynamique, la droite traditionnelle se radicalise. Takaichi Sanae, probable future Première ministre, alimente les stéréotypes : elle a récemment accusé des touristes étrangers de “maltraiter” les daims du parc de Nara; sans preuve, mais avec un large écho médiatique.
Ces récits viraux, souvent infondés, servent de leviers politiques, en désignant des coupables faciles pour détourner l’attention des enjeux économiques ou démographiques.
💬 Ce que cette phrase dit vraiment du Japon d’aujourd’hui
La déclaration de Moroi, au-delà du choc initial, met en lumière plusieurs dynamiques inquiétantes :
| Problème | Explication |
|---|---|
| Glissement sémantique | Confusion entre droits humains (universels) et droits civiques (réservés aux citoyens) |
| Instrumentalisation politique | Les étrangers deviennent des cibles idéales dans un contexte de crise identitaire |
| Vulnérabilité sociale | Des milliers de personnes vivent dans un vide juridique, sans filet de sécurité |
| Résistance démocratique | Des voix politiques et civiles s’élèvent encore pour défendre l’universalité des droits |
La vraie question, au fond, n’est pas celle du statut légal d’un individu, mais bien de la capacité du Japon à garantir une dignité égale à chacun, peu importe sa nationalité.
Comme on l’écrit souvent le Japon de 2025 est à un moment charnière. Face au vieillissement de sa population et à ses besoins en main-d’œuvre, il ne peut plus ignorer la place croissante des résidents étrangers. Pourtant, le discours public se durcit, et certains cherchent à faire des minorités les boucs émissaires d’une société en mutation.
La polémique autour de Moroi montre qu’il existe encore des garde-fous mais pour combien de temps ? L’avenir se jouera sur la capacité à affirmer haut et fort que les droits humains ne s’arrêtent pas à la frontière d’un passeport.
📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.
