La question du féminisme dans les œuvres issues du manga et de leurs versions animées revient régulièrement.
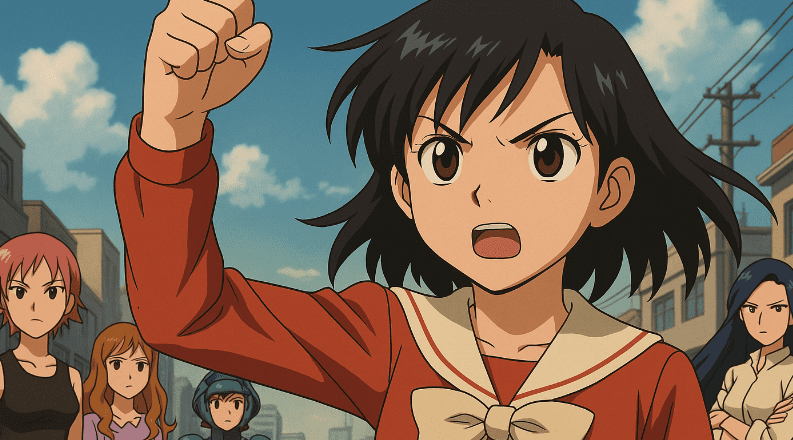
Le sujet féministe est souvent présent lorsque l’on parle manga pour dénoncer le sexisme qui y règne… Cela se vérifie notamment dans la catégorie des shōnen, destinée – sur le papier du moins – à un public de jeunes garçons et adolescents (comme toute production artistique et littéraire, rappelons que le monde du manga est très diversifié).
À lire aussi sur dondon.media : ⚖️ Justice au Japon
Il s’agit de la production la plus rentable au Japon (pensons aux œuvres cultes One Piece, Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, L’Attaque des Titans, etc.).
À l’image du terme « roman » qui peut désigner un polar, une romance, de la fantasy ou un témoignage, « manga » est un terme générique couvrant de nombreuses catégories parmi lesquelles le shōnen (pour jeunes garçons), le shōjo (pour jeunes filles), le seinen (pour adultes), le josei (pour femmes adultes), le hentai (érotique) et bien d’autres.
Chaque catégorie regroupe des mangas et animés souvent pensés pour un public cible. Le shōjo, par exemple, est la version dite féminine du shōnen : il s’agit souvent d’histoires de romances collégiennes ou lycéennes, destinées à un public de jeunes filles et adolescentes. Ces deux catégories sont parmi les plus connues en France.
Le sexisme dans les mangas, késkécé ?
Nous l’avons dit, l’univers du manga est très varié, avec des tons différents selon le public visé. Non, les mangas ne se résument pas qu’au sang, à la bagarre et aux cris – on en trouve, certes, dans certaines œuvres et catégories, mais on ne peut pas tout réduire à cela (et puis cela ne diminue pas forcément la qualité d’une histoire).
De même, il ne s’agit pas ici de dire que tous les mangas sont sexistes, ni de réduire certaines œuvres uniquement à cela.
Néanmoins, force est de reconnaître qu’il n’est pas rare de trouver des éléments problématiques associés à certains personnages féminins. La plupart du temps le sexisme peut passer par :
- Le dessin des personnages (design, mise en scène)
- Les dialogues entre personnages
- Le message global véhiculé par l’œuvre (de façon plus ou moins explicite, plus ou moins volontaire)
Le visuel est souvent le premier contact que nous avons avec une série, et c’est aussi un exemple très parlant du sexisme dans le manga. Le corps des personnages féminins est souvent sexualisé, uniformisé, avec une caractérisation très exagérée des attributs considérés comme “féminins” et “sexy” pour un public masculin : poitrine et fessier disproportionnés, taille de guêpe, etc. C’est un procédé de fan service assez courant dans les shōnen.
Par exemple, dans le manga Fairy Tail d’Hiro Mashima, presque tous les personnages féminins correspondent à ce stéréotype, et on ne compte plus le nombre de fois où elles se retrouvent en tenues minimalistes voire à demi nues, sans autre raison que de les sexualiser aux yeux du lecteur. Même de très jeunes filles pas encore formées ont droit à leur plan fesses. Et des plans poitrine ou plans cul, qu’est-ce qu’on en trouve dans certains animés !
Dans Grimgar (light novel d’Ao Jūmonji illustré par Eiri Shirai, adapté en animé disponible sur Netflix), presque tous les plans centrés sur des personnages féminins consistent à mettre en valeur une partie de leur corps – sans parler de l’animation des poitrines, qui semblent presque vivre leur propre vie indépendamment du reste du corps…
Un petit florilège bien parlant : tenues archi-moulantes, poses suggestives, angles de vue plongeants… On a parfois l’impression que les héroïnes ne sont là que pour servir de fan service.
Dans des shōnen à succès comme One Piece ou Fairy Tail, les personnages féminins sont ainsi souvent réduits à leur corps sexualisé ; les héroïnes y portent des tenues très légères, et leur plastique est idéalisée (la poitrine de Nami dans One Piece, par exemple, semble avoir mystérieusement augmenté de volume au fil du manga).
Ces séries vont jusqu’à faire des femmes de véritables objets décoratifs, presque toujours présentés avec une forte poitrine. On parle bien ici de procédés pensés pour flatter les fantasmes du public masculin – quitte à ne pas trop respecter la gravité ni la cohérence anatomique. Bref, le fan service sexuel est monnaie courante.
Naruto, lui, est un exemple de sexisme plus discret mais pas moins présent (avertissement : nous allons spoiler la fin de ce manga, âmes sensibles s’abstenir !). L’œuvre de Masashi Kishimoto compte de nombreux personnages féminins, avec des caractères, des intérêts et des physiques variés ; le fan service y est visible par moments, mais reste modéré. Pourtant, si l’on prend du recul et qu’on analyse Naruto dans sa globalité, on constate que l’œuvre véhicule (sans le dire explicitement) une image stéréotypée des femmes, et le message qu’on en retire n’est pas très valorisant.
Certes, les femmes peuvent y être ninja et se battre aux côtés des hommes… mais bien souvent elles sont reléguées aux rôles de soutien pour les héros masculins. Sakura, par exemple, fait partie du trio principal aux côtés de Naruto et Sasuke : or elle a à peu près autant d’utilité scénaristique qu’un coin de table durant la majeure partie de l’histoire.
Même si elle évolue un peu par la suite, son rôle principal (confirmé à la fin de la série) reste avant tout d’être le love interest de Naruto, et l’amoureuse éperdue de Sasuke. L’épilogue du manga enfonce le clou en montrant la plupart des personnages féminins devenues mères (et donc femmes au foyer), pendant que les hommes, eux, continuent leur carrière de ninjas et gagnent en responsabilités dans le village.
Ce schéma d’ensemble est malheureusement assez fréquent : dans bon nombre de shōnen, les héroïnes ont des pouvoirs ou compétences moindres, ou bien des rôles très stéréotypés (souvent soigneuses ou magiciennes, quand les hommes sont sur le front). Kishimoto lui-même aurait reconnu avoir du mal à créer des personnages féminins fort.
Dans Naruto, on trouve certes des kunoichi puissantes… mais jamais au niveau de leurs camarades masculins : Sakura a beau acquérir une force colossale en s’entraînant avec Tsunade, elle n’atteindra jamais le niveau de Sasuke ou Naruto, restant toujours en retrait derrière eux.
Ce n’est pas un hasard si, dans Naruto, la plupart des équipes de ninja comptent un seul membre féminin pour deux garçons (quand il y en a une). On pourrait multiplier les exemples de ce déséquilibre récurrent dans les rôles et la puissance accordés aux personnages selon leur genre.
La société japonaise fonctionne sur des codes et des traditions différentes des nôtres, où la place des femmes demeure assez traditionnelle. Pour certains, cette mentalité différente transparaît dans les produits culturels nippons, ce qui expliquerait la récurrence des clichés sexistes dans beaucoup de mangas.
Face à cela, deux attitudes coexistent :
- Ceux qui gardent un œil critique sur leurs lectures et pointent du doigt ces travers sexistes quand ils les voient.
- Ceux qui refusent de porter tout jugement sur la question, avec le sacro-saint argument : « Les mangas sont faits par des Japonais, pour les Japonais, dans la société japonaise ; les étrangers n’ont pas à juger un pays qui n’est pas le leur. »
Certes, nul ne nie les différences culturelles. Mais alors, que faire ? Ne pas en parler du tout ? Rappelons que les droits humains sont censés être universels et s’appliquer à tou·te·s, sans exception.
Le problème du sexisme dans une œuvre, c’est qu’il transmet un message au public (parfois très jeune) et vient alimenter les discriminations bien réelles dont sont victimes les femmes, quel que soit le pays. On peut apprécier un manga et en même temps reconnaître que certains aspects posent problème et méritent d’être discutés.
En France, c’est mieux qu’au Japon ?
Que nenni ! Attention, il ne s’agit pas de sombrer dans un manichéisme où la vision française serait le modèle absolu à suivre et à imposer aux autres. D’ailleurs ce sont bel et bien les éditeurs français de mangas qui font preuve de sexisme.
Prenons la catégorie shōjo telle que nous l’avons présentée plus haut (romances d’ado) : c’est une définition réductrice, forgée par les éditeurs en France. Au Japon, le label shōjo recouvre certes des romances, mais aussi des genres comme l’horreur, la fantasy ou d’autres titres aux sujets plus matures – y compris des thèmes graves ou violents rarement présents dans les shōnen. Pourtant, lorsqu’ils importent ces œuvres, les éditeurs français décident souvent de les re-catégoriser pour mieux les vendre, les présentant par exemple comme des seinen (manga pour adultes hommes).
Le shōjo étant une catégorie minoritaire en France et souffrant de préjugés, ils préfèrent changer l’étiquette pour toucher un plus large public, perpétuant ainsi l’idée que les mangas « pour filles » ne peuvent pas s’attaquer à des sujets sérieux ou sombres.
Autre exemple de sexisme bien de chez nous : en 2016, on a reproché au Festival International de la BD d’Angoulême de n’avoir sélectionné que des hommes (trente, tout de même) parmi les nominés au Grand Prix du festival. Le délégué général du festival s’était défendu en expliquant qu’il y avait « malheureusement peu de femmes dans l’histoire de la bande dessinée », et que c’était une réalité historique.
Or, même si le statut et les conditions de travail des autrices de BD ont longtemps été précaires, il existe tout de même de nombreuses femmes dans ce milieu – notamment au Japon, qui est l’un des pays comptant le plus de dessinatrices de manga au monde.
On peut citer par exemple Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist), Ai Yazawa (Nana), Yana Toboso (Black Butler), ou encore Rumiko Takahashi (Inuyasha, Ranma ½) !
Mais alors, quid du féminisme dans tout cela ?!
Heureusement, le manga est un médium très varié, et s’il y a encore beaucoup de sexisme, on trouve aussi un grand nombre d’œuvres intéressantes qui proposent une vision différente – où les personnages féminins ne sont pas relégués aux clichés du genre. À sa manière, le shōjo – dont les protagonistes sont souvent des personnages féminins – offre un accès privilégié à la conscience et au monde intérieur de ses héroïnes, ce qui leur donne une vraie substance interne.
Des éléments qui ne sont pas sans rappeler la technique littéraire du stream of consciousness (courant de conscience) prisée par l’écrivaine féministe Virginia Woolf.
Plus concrètement, on peut parler d’œuvres telles que Fullmetal Alchemist. Ce shōnen imaginé par une femme (Hiromu Arakawa) propose des personnages variés, travaillés, qui ont une vraie importance dans l’histoire quel que soit leur genre. Le fan service y est très discret, et même si certains personnages féminins restent en retrait, on y voit des femmes militaires, mécaniciennes, gardes du corps… mais aussi bibliothécaires ou femmes au foyer, sans que jamais l’œuvre ne les ridiculise pour ce qu’elles sont.
Dans un autre registre, les films d’animation de Hayao Miyazaki ont, bien avant les Américains de chez Disney, exploré de façon plus ou moins ouverte la question du genre et des stéréotypes qui y sont liés (on pense à Princesse Mononoké ou Le Voyage de Chihiro, où les héroïnes font preuve de courage et d’autonomie). Il semblerait d’ailleurs que, malgré les différences culturelles entre nos deux pays, le Japon évolue dans le sens de plus de parité et d’égalité entre les sexes, avec la publication d’œuvres récentes explicitement engagées sur ces thématiques.
Depuis quelques années, les mangas à thématiques féministes se multiplient et constituent même une porte d’entrée pédagogique pour aborder ces sujets.
En somme, le paysage du manga reflète des tendances sexistes persistantes mais aussi d’indéniables évolutions positives. Loin des clichés figés, de plus en plus d’autrices et d’auteurs proposent des récits nuancés, mettant en scène des héroïnes complexes et indépendantes et abordant de front les inégalités de genre.
Comme souvent, la culture (même populaire) est le reflet d’une société en mouvement. Au Japon, les mentalités changent : une part croissante de la population (notamment les jeunes) s’exprime désormais en faveur d’une plus grande égalité et d’un recul du patriarcat.
Et le manga, en tant que terrain d’expression privilégié, accompagne et stimule ce bouillonnement. Aux éditeurs et aux lecteurs – japonais comme français – de continuer à encourager ces œuvres qui bousculent les codes… pour le meilleur, espérons-le !
📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.
