À travers les rayons chargés de figurines et les bulles colorées des shōnen ou shōjo, une certaine vision de la femme persiste.
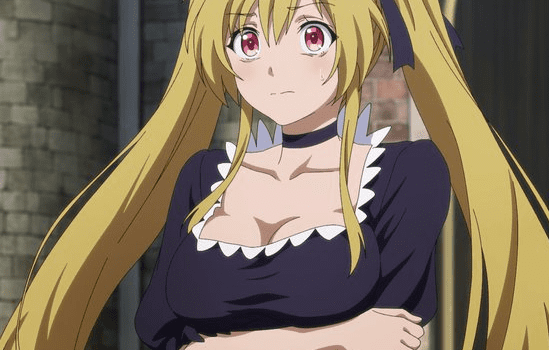
⚡ Le manga est vecteur d’imaginaires : il ne s’agit pas de rejeter un art qui passionne des millions de personnes, mais d’apprendre à le lire avec plus de recul, à questionner ce qu’on y voit et à soutenir les œuvres qui proposent une autre voie.
Au cœur de la Japan Expo, entre les effluves de gyozas et les photos de cosplay, une question gronde doucement dans les esprits des fans : quelle place donne-t-on vraiment aux femmes dans les mangas ?
Féminité déformée et manga
De plus en plus de personnes pointent du doigt l’hypersexualisation récurrente dans les mangas, notamment dans les shōnen. Petites tenues, poses suggestives, formes exagérées : le corps des femmes devient parfois plus un argument marketing qu’un personnage à part entière.
À lire aussi sur dondon.media : 🍑 Musée du sexe japonais « Hihokan » à Atami (熱海秘宝館)
Et derrière les vitrines, dans les pages même des mangas, ces clichés sont tenaces : héroïnes soumises, blagues graveleuses, agressions banalisées. Bien sûr, il existe des contre-exemples, des titres où les femmes brillent par leur force, leur complexité, leur indépendance. Mais la fréquence des contenus problématiques interroge.
Pourquoi #MeToo n’a-t-il pas marché au Japon ?
En Occident, le mouvement #MeToo a provoqué une onde de choc salutaire, remettant en question des décennies d’impunités et de stéréotypes. Au Japon, en revanche, la révolution n’a pas eu lieu.
Christine Lévy, chercheuse spécialiste du genre au Japon, résume la situation : « Il n’y a pas eu de débat de société. » Dans un pays où le modèle féminin reste encore largement traditionnel, le sexisme latent de certains mangas n’a jamais été remis en cause à grande échelle.
Résultat : le manga continue de refléter des archétypes profondément ancrés. Des collégiennes sexualisées, des carriéristes diabolisées, des scènes d’agression présentées comme des moments de tendresse… Et parfois, ce sont les lecteurs eux-mêmes qui finissent par intérioriser ces stéréotypes.
Les classiques d’hier deviennent parfois les malaises d’aujourd’hui. Prenons l’exemple de City Hunter, manga culte des années 80. Ryô Saeba y enchaîne les comportements de harceleur dans un cadre humoristique. Ce genre de ressort comique, jadis considéré comme inoffensif, paraît aujourd’hui daté – voire franchement déplacé.
Mais ce type de « fan service » ne s’est pas arrêté là. Au contraire, il s’est sophistiqué et amplifié : zoom suggestif sur les courbes des héroïnes, nudité accidentelle, situations ambigües… Les éditeurs japonais, conscients de la demande d’un certain public, n’hésitent pas à demander davantage de ces scènes à succès.
Même des personnages adorés comme Nami dans One Piece n’échappent pas à cette logique de surenchère visuelle, au détriment parfois de leur profondeur narrative.
En France, deuxième marché mondial du manga, les éditeurs commencent à réfléchir à leur responsabilité. Certains, comme Panini Manga, avouent ne pas trop se poser de questions tant que le contenu ne dépasse pas certaines limites. D’autres, comme Doki-Doki ou Delcourt/Tonkam, osent modifier, adapter ou même censurer des scènes jugées trop problématiques.
Le changement, lent mais perceptible, commence aussi à émerger du Japon lui-même. De plus en plus de femmes occupent des postes de scénaristes, dessinatrices ou réalisatrices, et certaines intègrent une approche féministe dans leurs œuvres.
La série Sayonara Miniskirt d’Aoi Makino en est un exemple marquant : elle dénonce le harcèlement sexuel et interroge le regard posé sur les femmes dans la société japonaise.
En France, des autrices comme Elsa Brants montrent aussi qu’on peut faire du manga autrement, avec humour, légèreté et sans reproduire des schémas sexistes.
Malgré ces signaux positifs, le sujet reste largement absent des scènes officielles. À Japan Expo, aucune table ronde sur le sexisme dans les mangas n’était organisée en 2018. Par crainte de heurter la culture japonaise ? Par manque de volonté ?
Pourtant, le débat existe. Il se murmure dans les files d’attente, s’écrit sur les réseaux sociaux, se lit dans les marges des blogs ou se glisse dans les choix éditoriaux. Ce sont les lecteurs, les fans, les amateurs passionnés qui, par leur regard critique, commencent à faire évoluer les choses.
📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.
